Par Xavier Riaud
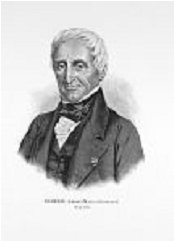
André Marie Constant Duméril (1774-1860)
(Corlieu, 1896, © BIUM).
André Marie Constant Duméril naît à Amiens, le 1er janvier 1774. En 1795, alors que l’Ecole centrale de santé vient d’être créée par Fourcroy à Paris, en 1794, Duméril est nommé « élève de la patrie » par le district d’Amiens. Médecin très jeune, il y officie en tant que prosecteur au bout d’à peine une année d’études. Fort de cette réussite, il présente sa candidature pour devenir chef de travaux anatomiques à l’Ecole pratique. Il l’emporte brillamment sur Dupuytren, son rival d’alors (http://correspondancefamiliale.ehess.fr, 2012). En 1800, arrivé à Paris, en association avec Georges Cuvier (1769-1832), père de l’anatomie comparée et de la paléontologie en France, il participe à la rédaction des Leçons d’anatomie comparée. Il est nommé professeur d’anatomie à l’Ecole de médecine de Paris, en 1801 (Dupont, 1999). En 1802, associé à Desgenettes, il est missionné pour étudier les épidémies dans les villes d’Orléans et de Pithiviers. En 1803, il succède à Lacépède (1756-1825), naturaliste et homme politique français, à la chaire d’herpétologie et d’ichtyologie du Muséum national d’histoire naturelle. En 1803, Duméril soutient sa thèse de doctorat devant Chaussier notamment, consacrée à la façon de perfectionner les techniques anatomistes. Elle n’est imprimée par Didot qu’en 1812 (http://correspondancefamiliale.ehess.fr, 2012). En 1804 (en 1803 selon Dupont (1999)), il fait paraître un Traité élémentaire d’histoire naturelle. En 1805, il étudie la fièvre jaune, pendant la campagne des armées napoléoniennes en Espagne (Dupont, 1999). En 1806, il publie une Zoologie analytique qui aborde l’ensemble du règne animal, s’attarde sur les relations entre les genres, sans citer les espèces. En 1808, lors de la création de l’Université impériale, associé à Chaussier, il s’affaire à la chaire d’anatomie et de physiologie. De 1811 à 1818, il voyage beaucoup sur le territoire français pour participer à des jurys de thèse (http://fr.wikipedia.org, 2012).
En 1813, à la mort de son beau-père, Daniel Delaroche, et de son beau-frère, François, il hérite de leurs clientèles et soigne des familles genevoises très aisées de la capitale. Il est nommé au poste de médecin de l’hôpital du faubourg Saint-Martin, ou Maison de Santé. Submergé par ses diverses responsabilités, il finit par renoncer à l’enseignement et aux jurys de thèse en 1819 (http://correspondancefamiliale.ehess.fr, 2012).
En 1816, il est élu membre de l’Académie des sciences. Duméril remplace aussi Cuvier à l’Ecole centrale du Panthéon. Le 27 décembre 1820, il entre à l’Académie royale de médecine dès sa fondation. En 1823, il devient professeur de pathologie interne à la Faculté de médecine de Paris. Il permute ainsi de discipline et y reste jusqu’en 1830 (http://correspondancefamiliale.ehess.fr, 2012).
De 1821 à 1830, le Dictionnaire des sciences naturelles paraît en cinquante volumes. Duméril consacre un volume complet à la classe des insectes qu’il agrémente de soixante planches originales. Il écrit également, dans ce dictionnaire, tous les articles relatifs à l’entomologie.
Son travail médical lui pèse. Il abandonne progressivement sa clientèle privée et cesse ses activités d’enseignement à la Faculté de médecine.
En 1832, il est assisté de Gabriel Bibron (1805-1848), zoologiste, qui s’occupe de la description des espèces, et de Nicolaus Michael Oppel (1782-1820), naturaliste allemand. Lorsque Bibron meurt subitement, c’est Auguste Duméril (1812-1870), son fils, également médecin, qui le rejoint. Mais, cette disparition soudaine retarde toutes les parutions en cours (http://fr.wikipedia.org, 2012). En 1832 également, à la mort de Cuvier, Duméril renonce à lui succéder au Muséum national d’histoire naturelle, la charge de travail et de responsabilités l’effrayant. Il renonce aussi à lui succéder au poste de Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences pour les mêmes raisons (http://correspondancefamiliale.ehess.fr, 2012). C’est seulement en 1851 que le père et son fils co-écrivent le Catalogue méthodique de la collection des reptiles. Duméril père réalise de plus une classification en sept tomes de tous les serpents dans Prodrome de la classification des reptiles ophidiens qui paraît en 1853. L’Erpétologie générale ou Histoire naturelle complète des reptiles est publiée en neuf volumes de 1834 à 1854. 1 393 espèces sont détaillées et décrites sur un plan anatomique et physiologique (http://fr.wikipedia.org, 2012).
Lorsque le choléra fait des ravages dans la capitale, Duméril se dévoue sans compter, à ses risques et périls. Son mérite est si grand que la ville lui décerne une médaille d’argent en 1850.
En 1853, il forme son fils dans ses postes et fonctions, et se retire définitivement, en décembre 1856. Auguste lui succède alors en 1857. André Marie Constant demande alors la permission à ses confrères de conserver un titre de professeur honoraire (http://correspondancefamiliale.ehess.fr, 2012).
En 1860, très intéressé également par les insectes, il signe une Entomologie analytique en deux volumes. Avec Auguste, son fils, ils mettent en place le premier vivarium pour reptiles au Jardin des Plantes (http://fr.wikipedia.org, 2012). Deux mois avant sa mort, il est élevé au rang de commandeur de la Légion d’honneur. Il meurt le 14 août 1860. Il est enterré au cimetière du Père-Lachaise.
Il convient de citer également Jean Charles Antoine Duméril (1765- ?) qui est un frère dispendieux à l’extrême, souvent engagé dans des affaires très troubles. En 1794, il est d’ailleurs emprisonné. André Marie Constant se plaint maintes fois de son frère à ses parents. Grâce au soutien de ses frères notables, Jean Charles Antoine accède à la fonction de directeur principal des hôpitaux de la Grande Armée en 1807. Il quitte ce poste en 1808 (http://correspondancefamiliale.ehess.fr, 2012).
Références bibliographiques :
Bibliothèque interuniversitaire de Santé (BIUS), communication personnelle, Paris, 2012.
Dupont Michel, Dictionnaire historique des médecins dans et hors de la Médecine, Larousse (éd.), Paris, 1999.
http://correspondancefamiliale.ehess.fr, Duméril, 2012, pp. 1-5.
http://fr.wikipedia.org, André Marie Constant Duméril, 2012, pp. 1-3. |
|